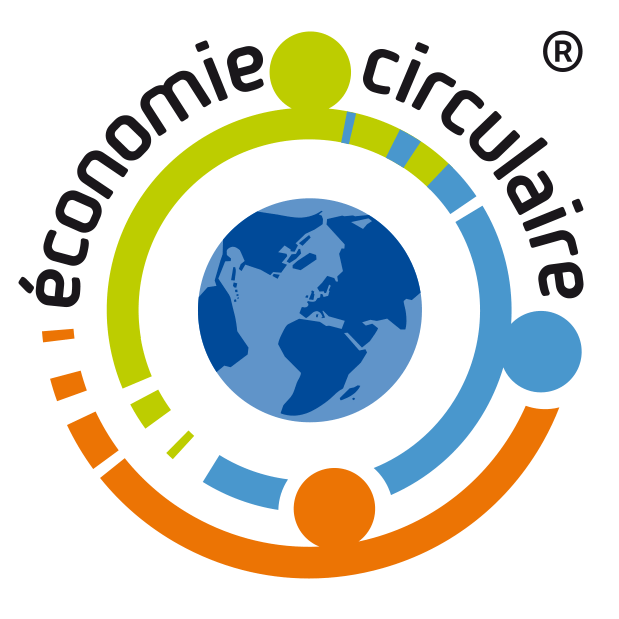Valoriser les déchets en énergie (chaleur, électricité, carburant) consiste à les détourner de l’enfouissement après avoir priorisé leur réduction, leur réemploi et les recyclages des matières. La valorisation permet de produire de l’énergie localement et de diminuer la consommation de combustibles fossiles.
Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale de gestion des déchets et de production d’énergie.
Le cadre réglementaire (lois LTECV et AGEC, Code de l’Environnement) couvre la prévention des déchets, la gestion des émissions, les incitations économiques et les obligations de performance.
Qu’est que la valorisation énergétique des déchets?
La valorisation énergétique des déchets consiste à utiliser ces derniers pour produire de l'énergie, en les transformant en sources de chaleur, d'électricité ou de carburant.
Les installations de valorisation énergétique des déchets sont soumises à une réglementation stricte. L’objectif est de minimiser les impacts environnementaux, notamment les émissions de polluants atmosphériques et la gestion des résidus de combustion. Les services de l’État contrôlent ces installations.
L’ADEME aide les collectivités à optimiser les performances de leurs unités de valorisation énergétique (UVE, autre appellation pour les incinérateurs) des déchets et soutient le développement de la production d’énergie issue des combustibles solides de récupération (CSR).
Hiérarchie des modes de traitement
La valorisation énergétique des déchets est le dernier recours dans la hiérarchie des modes de traitement, juste avant le stockage des déchets en installations dédiées.

- Prévention
- Réutilisation
- Recyclage
- Valorisation énergétique
- Mise en décharge / enfouissement
Objectifs réglementaires
La valorisation énergétique des déchets répond à des exigences réglementaires et s’inscrit dans les objectifs de la stratégie française pour l’énergie et le climat (programmation pluriannuelle de l’énergie).
Les objectifs réglementaires pour la valorisation énergétique des déchets en France s'inscrivent dans un cadre législatif et stratégique visant à promouvoir une gestion durable des déchets et à réduire leur impact environnemental. Ces objectifs sont définis par plusieurs lois, directives et plans nationaux.
La hiérarchisation des modes de traitement des déchets en France impose le tri des déchets. Il peut se faire soit à la source ou dans des installations spécifiques, comme les centres de tri. L’objectif est de favoriser la valorisation matière. Toutefois, certains déchets, comme les ordures ménagères, peuvent être directement valorisés énergétiquement via des unités de valorisation énergétiques, dit UVE avec récupération de la chaleur.
Les actions de tri pour valorisation matière entraînent des « refus de tri » qui peuvent également être valorisés énergétiquement sous la forme de combustibles solides de récupération (CSR) dans des chaudières dédiées. Ainsi, les réglementations visant à améliorer la valorisation matière ou à réduire la mise en décharge peuvent avoir un impact sur les filières de valorisation énergétique des déchets.
Aperçu des principaux objectifs réglementaires dans ces domaines :
1. Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV)
- Réduction de la mise en décharge : Diminuer de 50 % la quantité de déchets mis en décharge d’ici 2025 par rapport à 2010.
- Recyclage des déchets non dangereux : Atteindre un taux de recyclage de 65 % des déchets non dangereux d’ici 2025.
2. Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC)
- Hiérarchie des modes de traitement des déchets : Prioriser la réduction à la source, la réutilisation, et le recyclage avant la valorisation énergétique et l’élimination.
- Objectif de recyclage des emballages plastiques : Recycler 100 % des plastiques d’ici 2025.
- Réduction des déchets : Réduire de 15 % la quantité de déchets ménagers par habitant d’ici 2030 par rapport à 2010.
3. Plan National de Prévention des Déchets
- Prévention : Réduire la production de déchets.
- Valorisation matière et organique : Améliorer le taux de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés.
4. Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
- Taux de recyclage : Atteindre des objectifs spécifiques de recyclage et de valorisation fixés par les régions.
- Réduction des déchets résiduels : Réduire la quantité de déchets résiduels produits et améliorer leur valorisation énergétique.
5. Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
- Incitation financière : Encourager la valorisation énergétique en modulant les taux de la TGAP en fonction du mode de traitement des déchets, favorisant les installations qui valorisent les déchets énergétiquement plutôt que de les mettre en décharge ou de les incinérer sans récupération d'énergie.
6. Responsabilité Élargie des Producteurs (REP)
- Filières REP : Les producteurs sont responsables de la fin de vie de leurs produits, incluant la gestion de la valorisation énergétique des déchets.
- Contribution financière : Les metteurs sur le marché doivent financer la collecte, le traitement et la valorisation des déchets issus de leurs produits.
En conclusion, les objectifs réglementaires de valorisation énergétique des déchets en France visent à réduire la quantité de déchets mis en décharge et à utiliser les déchets résiduels pour produire de l'énergie. Ces objectifs sont soutenus par un cadre législatif et réglementaire solide, comprenant des normes strictes et des plans de gestion des déchets à l'échelle nationale et locale.
Les différents procédés de valorisation énergétique des déchets
L’incinération (ou UVE) : principal mode de production énergétique à partir de déchets
L'incinération des déchets est un procédé de traitement des déchets solides par combustion à haute température (entre 850 et 1 100°C). Ce procédé réduit considérablement le volume des déchets et produit de l'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.
La chaleur générée par la combustion est utilisée pour produire de l'énergie.
Cette chaleur peut être captée par des chaudières pour produire de la vapeur, qui peut être utilisée de différentes manières :
- Production d'électricité : La vapeur alimente des turbines qui génèrent de l'électricité.
- Chauffage urbain : La chaleur est distribuée via des réseaux de chauffage urbain pour chauffer des bâtiments résidentiels ou industriels.
En France, l’incinération des déchets ménagers est le principal mode de production énergétique à partir de déchets.
En 2020, le pays compte 119 unités d'incinération des ordures ménagères (UIOM). Parmi elles, 117 valorisent les déchets en énergie (UVE), produisant 15,3 TWh par an d’énergie (2/3 de chaleur et 1/3 de cogénération). Entre 2000 et 2020, les tonnages incinérés avec récupération d’énergie ont progressé de 10,3 à 14,5 millions de tonnes par an, sans augmentation significative du nombre d’installations d’incinération.
L’incinération est régie par un encadrement réglementaire strict (ICPE 2771) qui impose une surveillance continue des rejets pour prévenir des impacts environnementaux.
Cette réglementation fixe des valeurs limites d’émission pour les principaux polluants libérés par les déchets, notamment les oxydes d'azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), les particules fines, les dioxines et les métaux lourds.
- Chiffres clés sur les déchets renouvelables
(DATALAB, Ministère de la transition énergétique, 2023)
Les combustibles solides de récupération (CSR)
Les déchets qui ne peuvent pas être triés ou recyclés, comme les refus de tri de déchets d’activités économiques (DAE) et des déchets ménagers peuvent être transformés en combustibles dans des centres spécialisés. Certains déchets de chantiers et déchets non-recyclables provenant de déchèteries sont également orientés vers ces filières.
Ces combustibles, appelés Combustibles Solides de Récupération (CSR), sont définis comme “déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible […] » (Article R.541-8-1 du Code de l’environnement)
Usages industriels
Ces CSR sont brûlés dans des chaufferies spécifiques (rubrique ICPE 2971) pour produire de la chaleur et de l’électricité, principalement pour des usages industriels. Ce procédé permet de réduire la quantité de déchets non valorisables mis en décharge et de diminuer la consommation d’énergie fossile, en conformité avec les réglementations nationales et européennes. Les CSR peuvent également être utilisés par les cimenteries pour réduire leurs consommations d’énergie. Contenant en moyenne entre 40 à 55 % de carbone biogénique (provenant des fractions de bois, de papier et de cartons non valorisables), les CSR contribuent à la décarbonation de la production d’énergie lorsqu’ils remplacent les combustibles fossiles comme le gaz, le fuel et le charbon.
La filière CSR est une filière en émergence
En France, la filière est encore en développement. À la fin de 2023, trois installations de valorisation énergétique des CSR sont en fonctionnement. Ces installations sont :
- Blue Paper à Strasbourg : Gérée par BLUE PAPER SAS, cette installation utilise une chaudière CSR de 18 MW pour remplacer deux chaudières à gaz, alimentant ainsi la production de papier pour ondulé (PPO) (BioÉnergies Francophone) (Paprec).
- Séché Eco-industries à Laval : Gérée par Séché, cette installation utilise un four CSR à lit fluidisé d’une puissance de 10 MW pour alimenter en chaleur le réseau de chaleur de la ville de Laval et l’usine Déshyouest pour la déshydratation de fourrage.
- B+T à Chalampé en région Alsace, pour la production d’une partie d’énergie pour l’industriel Alsachimie en remplacement de l’utilisation du gaz.
Pyrolyse et gazéification
La pyrolyse et la gazéification consistent à chauffer des déchets à très haute température en l’absence d’oxygène afin de produire un gaz de synthèse (« syngaz ») valorisable en combustible, électricité ou chaleur. Ce procédé génère également un résidu solide « char » et des résidus liquides, notamment des huiles.
La gazéification hydrothermale est spécifique pour traiter les boues de stations d’épuration et les effluents d’élevage. Actuellement, cette technologie n'est pas applicable aux combustibles tels que les CSR.
De même, la pyrolyse est actuellement une technologie fonctionnelle uniquement pour traiter du bois non dangereux en fin de vie, comme le bois B provenant de démolitions, des bois d'œuvre ou des panneaux.
En 2024, la pyrolyse et la gazéification pour le traitement des déchets en mélange tels que les CSR sont des techniques encore non éprouvées, avec des installations dédiées restant à l'état de démonstrateurs.
Ressources recommandées par l’ADEME pour comprendre la valorisation énergétique
La FNADE accompagne et soutient les professionnels du déchet depuis 1937. Grâce à cette longue expérience, la FNADE travaille aux côtés des acteurs de la filière pour représenter et défendre leurs intérêts.
- Guide Performances, recettes et coûts de traitement thermique des déchets (AMORCE, données 2020 – 2021)
AMORCE, en partenariat avec l'ADEME, a mis à jour son enquête intitulée « Performances et recettes des unités de valorisation énergétique des ordures ménagères (UVE) ». Cette enquête aide les responsables des unités de traitement thermique des déchets à se comparer aux autres unités en France. Les résultats couvrent plusieurs aspects, y compris les prix de vente de la chaleur et de l'électricité.
- Etat des lieux national des unités de préparation de combustibles solides de récupération (AMORCE, 2021 - PDF 4,24 Mo)
AMORCE a mené une enquête sur les unités de production de CSR en activité en France. Cette publication présente les résultats de ce bilan.
- Synthèse de l’étude du modèle économique de la filière des Combustibles Solides de Récupération (FNADE, 2023 - PDF 951 Ko)
Ce document, publié par la FNADE et le SN2E, propose une synthèse du modèle économique du CSR en France. Il examine les aspects économiques de la production et de l'utilisation du CSR, en mettant en lumière les coûts, les revenus et les facteurs clés de rentabilité. Cette analyse détaillée vise à fournir des informations précieuses aux acteurs du secteur, afin de mieux comprendre les dynamiques économiques et de soutenir le développement durable de cette filière.
Pour télécharger ce contenu, il est nécessaire de se connecter à son espace adhérent. Ce contenu n'étant pas en libre accès.
Questions et Réponses
Ce sont deux acronymes qui désignent ce que nous appelons communément un incinérateur à déchets. L’UIOM désigne une « usine d’incinération des ordures ménagères » et ne valorise pas toujours la chaleur fatale qui est produite. L’UVE désigne une « unité de valorisation énergétique » et valorise toute la chaleur produite en la distribuant vers un réseau de chaleur (chauffage urbain ou industriel) ou vers une turbine pour générer de l’électricité (cogénération chaleur et électricité).
La chaufferie CSR répond aux exigences de la rubrique 2971 (production d’énergie) des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) alors que l’UVE répond aux exigences de la rubrique 2771 (traitement des déchets non dangereux). La chaufferie CSR utilise un combustible issu de déchets en mélange provenant des activités économiques qui ont été triés au préalable pour récupérer toutes les matières valorisables et valoriser les refus de tri en les préparant selon les exigences de l’arrêté du 23 mai 2016 modifié à contrario des UVE où les déchets sont incinérés sans tri préalable.
L’ADEME publie régulièrement des appels à projets Energie CSR (7 AAP depuis 2016). Dans le cadre de ces dispositifs, les projets de production d’énergie à partir de CSR retenus font l’objet d’une convention de financement ADEME.
Par le passé, les incinérateurs à déchets étaient source de pollutions importantes faute de systèmes de traitement des rejets efficaces. Aujourd’hui, la législation française impose des seuils de rejets atmosphériques très bas. Le respect de ces exigences est assuré par des lignes de traitement des fumées très performantes et des systèmes de mesure en continu pour vérifier la conformité des rejets.